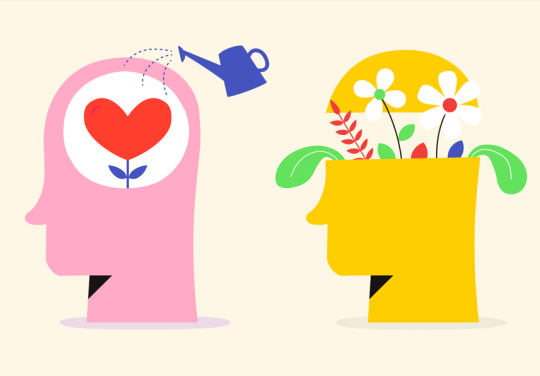Le programme consiste à proposer aux parents des enfants concernés – âgés de 3 ans et 9 mois à 4 ans et 6 mois et dont le médecin traitant exerce au sein de la MSP – en premier lieu et rapidement, une infirmière puéricultrice de la MSP. Ils entament ainsi un parcours en amont d’une éventuelle, mais pas automatique, prise en charge orthophonique.
Avant le premier rendez-vous, Karine Fillat, l’infirmière puéricultrice, leur fournit ainsi un questionnaire qui permet de réaliser une anamnèse de la petite enfance. Les réponses sont explorées lors de la première rencontre entre les parents et l’infirmière. "On revoit comment se sont déroulés la grossesse, la naissance, les premiers mois de l’enfant, explique-t-elle. On essaie de connaître ses antécédents médicaux, s’il a été hospitalisé, s’il a souffert de grosses pathologies, s’il est souvent malade et s’il a déjà fait des bilans ORL ou ophtalmologiques..." Elle s’enquiert aussi du fait qu’il tète encore souvent (son pouce, une tétine, un doudou, un biberon), et s’il passe du temps devant des écrans. Sur l’usage de la tétine, par exemple, elle s’adresse directement aux enfants, car "comme c’est une personne extérieure qui leur en parle, ils prennent cette parole différemment et on constate parfois à la séance suivante qu’ils ont arrêté de la téter".
Une grande part du rôle de l’infirmière réside aussi, lors de ce premier rendez-vous et par la suite, dans la guidance parentale. "On évoque les règles familiales mais aussi le temps que les parents consacrent à leur enfant et la manière dont ils communiquent avec lui, souligne Karine Fillat. On passe en revue tout ce qui peut engendrer un retard de langage. Pour certains, c’est un moment de prise de conscience qu’ils ne passent pas assez de temps avec leur enfant ou que celui-ci fait ce qu’il veut, avec les écrans notamment." Elle aborde avec eux la manière dont ils peuvent s’adresser à l’enfant, par exemple en se mettant à sa hauteur et en le regardant dans les yeux, le niveau de langage à employer, l’intérêt de la lecture…