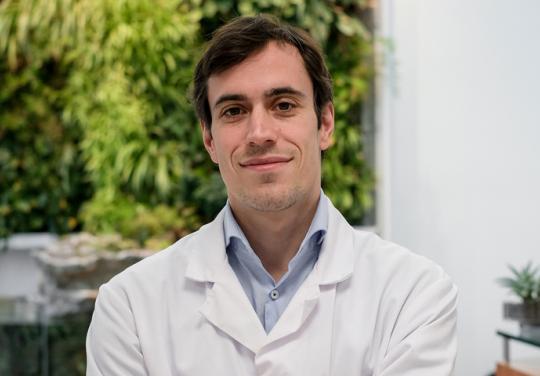Un environnement où "les rapports personnels avec les confrères n'étaient pas mauvais, mais où ceux-ci étaient tout de même vus comme des concurrents", se souvient le médecin généraliste. Dans les années 1990, toutefois, les praticiens du territoire se voient contraints de collaborer. "Notre petit hôpital s'est trouvé en difficulté pour assurer la continuité de ce qu'on n'appelait pas encore les soins non programmés. On nous a réunis pour trouver une solution, et plutôt que d'envoyer ces gens sur les roses, on s'est dit qu'on tenait vraiment à cet hôpital, que si le problème n'était pas résolu, cela allait nous retomber dessus... Et donc on s'est constitués en association pour assurer les gardes à l'hôpital." Modeste, celui qui estime qu'il n'était alors qu'un "médecin généraliste lambda" assure que c'est "un peu par hasard" que la présidence de l'association, baptisée Centre d'accueil des premiers soins (Caps), lui a échu.
Face à l'adversité et aux difficultés rencontrées par leur hôpital de proximité, les libéraux impliqués dans l'association découvrent de nouvelles réalités. "Avant même de parler de pluriprofessionnalité, on a appris à travailler ensemble, entre médecins. Et on a réalisé qu'on avait tous les mêmes contraintes, que si on s'envoyait nos patients, on ne se les piquait pas..."
Lors des gardes à l'hôpital, les rapports avec les infirmières transforment aussi le regard que ces médecins généralistes portaient sur leur propre métier. "On travaillait mieux, dans un environnement plus sécurisé. On s'est remis à faire des actes qu'on avait désappris à faire. Faire des plâtres, des sutures, c'est compliqué quand on est seul dans son cabinet, avec une salle d'attente pleine, quand le patient arrive avec un chiffon imbibé de sang et que les locaux sont inadaptés... Mais quand on a les équipes et les locaux, c'est différent."