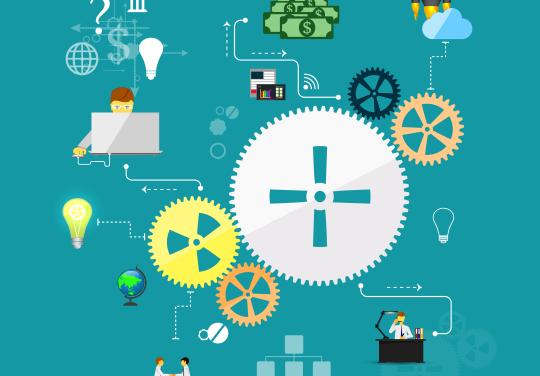À la Ville de Paris, Eve Plenel, sa directrice de la santé publique, confie avoir changé d’approche du territoire. Au départ, son approche était “très administrativo-politique, dans une forme de rapport de force avec l’Etat”, explique-t-elle. Le défi était “comment on sort de cette situation où on se dit que la santé est du domaine du régalien, un sujet national, piloté par l’Etat. Vous élus locaux, administrateurs territoriaux, vous circulez”. Désormais, le vrai sujet, pour elle, pour l’organisation des soins et des politiques de santé, c’est plutôt “le territoire social”. “Ce à quoi on œuvre, c’est comment documenter mieux et plus finement les besoins en santé d’un territoire, au-delà de ce que l’information administrative ou l’Assurance maladie peut nous dire”, et comment trouver des instances pour les partager, “qu'on soit producteurs d’infos sur nos territoires pour enclencher une discussion sur ce qu’on y développe”.
L’autre enjeu, fait-elle savoir, c’est : “Comment ce qu’on développe sur notre territoire ne vient pas encore un peu plus creuser les inégalités territoriales au sein de l’Ile-de-France ?” Cela passe par travailler à des liens forts avec la Seine-Saint-Denis, illustre-t-elle. Si pour elle, “l’idéal, c’est que ARS, Assurance maladie, professionnels de santé, collectivités territoriales, travaillent ensemble, ça bute encore quand même sur des cultures professionnelles ou politiques ou administratives qui ne sont pas complètement prêtes”, sur le fait que les ARS ne “sont pas encore suffisamment outillées en termes de compétences professionnelles sur autre chose que le sanitaire”.

La Mayenne, quant à elle, est divisée en deux territoires, décrit Maxime Lebigot, infirmier et co-président de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux, pour qui “la santé ne doit pas dépendre du code postal”. Le Sud, avec “beaucoup d’exercice coordonné depuis de nombreuses années”, où “au niveau de l’accès aux soins, ça se passe très bien”. Et le Nord et le centre, notamment à Laval, où ce n’est pas le cas. À Laval, il y a “eu beaucoup de difficultés pour que les médecins travaillent avec les autres professionnels de santé”, la CPTS “a été créée seulement l’an passé”, il y a “beaucoup de cabinets uniques”. En revanche, souligne-t-il, il y a une MSP en fonction depuis un an et demi. Et en Mayenne, salue-t-il, “on a eu la chance d’avoir le département également qui a mis en place un centre de santé avec des médecins retraités, qui accueille des internes”, en 2019, avec “une antenne à côté de Laval”. “On peut voir que quand tout le monde se met autour de la table et met de côté ses egos, commente-t-il, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent”. Pour Maxime Lebigot, il faudrait accentuer la formation des étudiants en médecine dans les zones périphériques. Il est aussi favorable à un conventionnement sélectif.
Pascal Biltz, membre fondateur de la Collégiale des CPTS de Paris - qui regroupe 9 CPTS parisiennes sur 16 -, rappelle qu’à la capitale, la notion de territoire est imposée par l’ARS. Sa définition du territoire, valorise-t-il, c’est “l’efficacité opérationnelle pour remplir les missions socles”. Et comme cela dépend de la dotation donnée en fonction de la taille, il invite à ne faire “que des CPTS de taille 3 ou 4”. Celle qu’il préside, dans le 19e, étant de taille 4. Si la CPTS, pour Pascal Blitz, “n’a pas la prétention de résoudre tous les problèmes de santé d’un territoire”, c’est “une invention tellement intelligente qu’on se demande pourquoi on ne l’a pas faite avant”. L’objectif, désormais, “c’est d’arriver à travailler de manière beaucoup plus proche, beaucoup plus souple et plus fréquente avec les autres acteurs”, Ville de Paris, ARS, CPAM...
“On territorialise patiemment les choses", observe Emmanuel Vigneron. Si pour lui “il y a du retard à l’allumage, il est évident que tout concourt à prévoir que, dans les prochaines années, grâce à toutes ces réflexions menées (...), la politique de santé fera une place de plus en plus grande à la notion de territoire”.