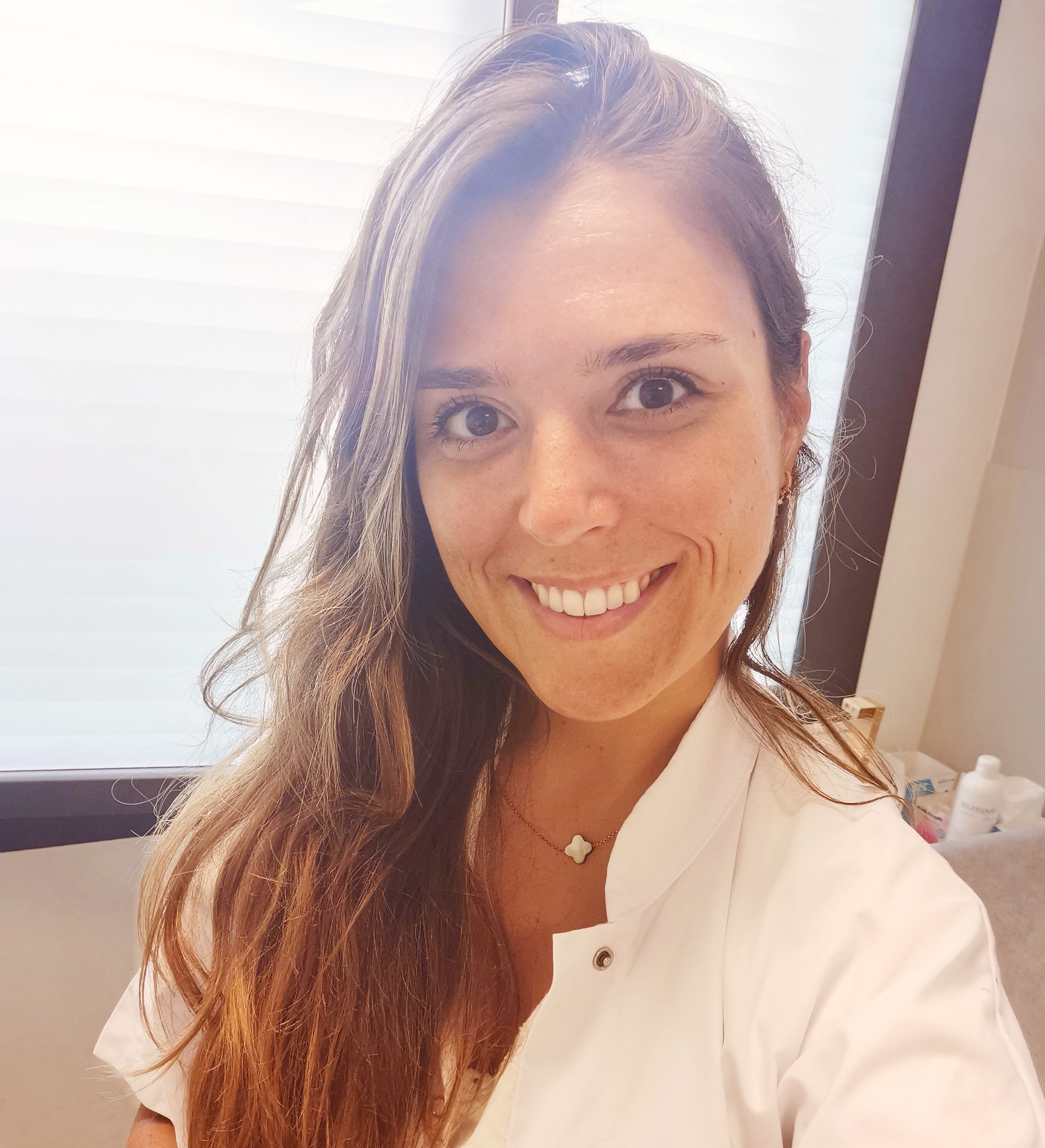Article publié dans Concours pluripro, février 2023
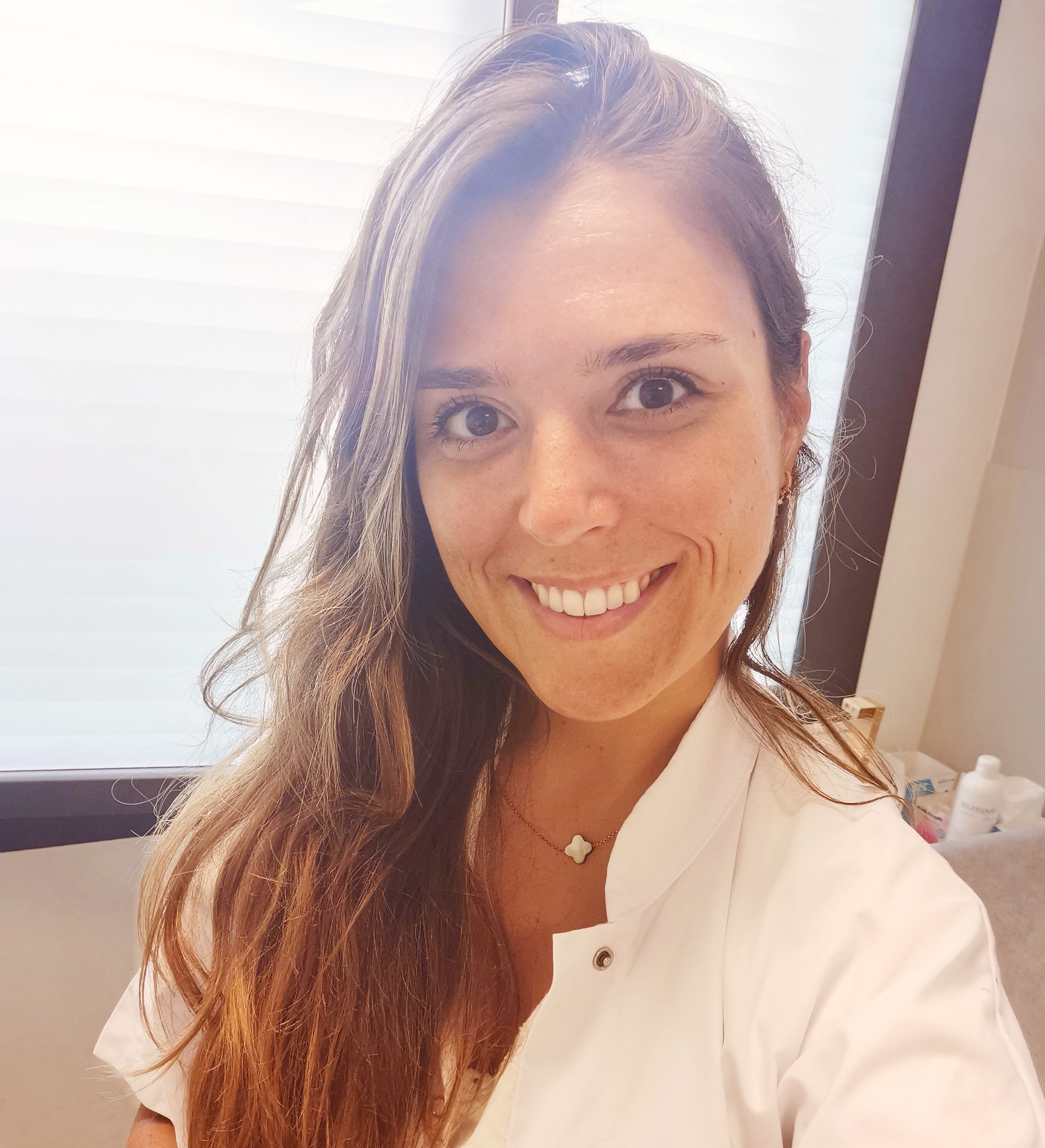
Comment la question de l'exercice coordonné s'est-elle imposée comme sujet de recherche pour votre thèse ?
Lorsque j'ai commencé à travailler en libéral il y a un peu plus d'un an, j'ai réalisé qu'il était indispensable d'avoir des correspondants à qui adresser des patients. En tant qu'interne à l'hôpital, je faisais tout le temps de l'exercice coordonné sans m'en rendre compte, car je travaillais en lien permanent avec d'autres médecins hospitaliers et des professionnels paramédicaux. En ville, l'exercice est plus solitaire, et je me suis intéressée à différentes formes de coordination avec d'autres praticiens. Ce sont mes échanges avec le Dr Renaud Ferrier, qui préside la CPTS Pays de Lérins (Paca), qui m'ont permis d'affiner mon sujet de recherche.
Et pour ce qui concerne la pratique du frottis ?
Le sujet mérite qu'on s'y penche, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes de moins de 50 ans, et 1 100 Françaises en meurent tous les ans. De plus, le taux de survie à cinq ans est en diminution. Pourtant, c'est un cancer évitable : il est possible de dépister les lésions précancéreuses de façon précoce et de les traiter.
Un dépistage national est pourtant organisé…
Oui, il y a une campagne nationale, et de nombreux praticiens sont habilités à réaliser des frottis : les gynécologues-obstétriciens mais aussi les généralistes, les sages-femmes, les biologistes, les anatomopathologistes, etc. Pourtant, le taux de couverture est seulement de 59 % au niveau national. Les patientes se souviennent rarement de qui a réalisé leur dernier frottis ou de quand date cet examen, et il est parfois compliqué d'avoir accès à leurs résultats. Pour certaines, on multiplie alors inutilement les examens, alors que d'autres laissent passer les échéances. Le manque de coordination entre professionnels de santé est évident et délétère pour les patientes.