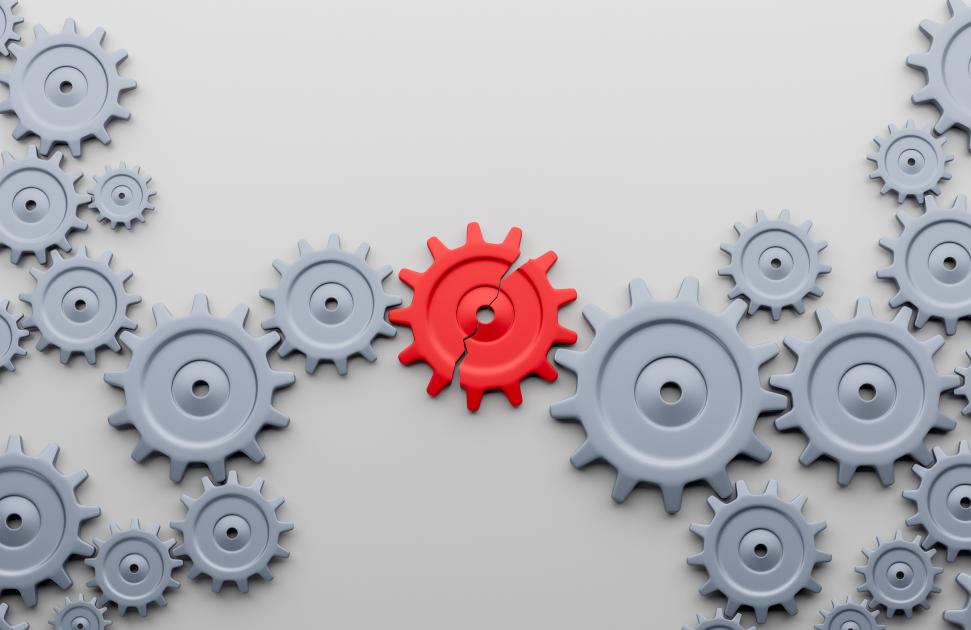Voilà des années que les évolutions nécessaires de notre système de santé sont, les unes après les autres, identifiées, formulées, présentées, discutées, souvent largement commentées et finalement timidement ou très partiellement mises en œuvre… Au point que le sentiment qui domine est que chaque évolution s’enlise, s’épuise, jusqu’à ce que l’innovation qu’elle portait se dilue dans un existant immuable, fort de son inertie.
On peut ainsi rappeler, en confondant les évolutions structurelles et d’autres davantage ponctuelles, le "virage ambulatoire" et son corollaire la "fluidité ville-hôpital", la priorité accordée aux "soins primaires", la "diversification des modes de rémunération", les "pratiques avancées" et les "nouveaux métiers", la "marginalisation de l’exercice isolé" et la montée en puissance du "travail en équipe" auquel on doit associer les "diverses fonctionnalités de la télésanté", le rapprochement "du sanitaire et du social" et last but not least le "repositionnement du patient au centre du système de santé" avec la finalité de répondre prioritairement à son ressenti* ; et sans oublier la saga du "dossier médical" partagé ou personnel (c’est selon), et celle, moins médiatisée de la misère de la prévention primaire, ou encore pour finir les mirages de la robotisation, de l’intelligence artificielle et dans un autre registre de la "responsabilité populationnelle". Des évolutions** qui, menées résolument à leur terme, auraient sûrement conduit à des améliorations très sensibles de notre système et, en réalité, aux conditions de prise en charge des malades et de la population.
Au passage, il faut souligner que ces diverses évolutions sont celles qui sont mises en œuvre dans l’ensemble des pays du périmètre de l’OCDE, depuis maintenant deux ou trois décennies, avec des résultats le plus souvent probants – largement diffusés et aisément accessibles, en particulier pour les pays scandinaves, l’Amérique du nord ou l’Australie – même si des "frottements" ont pu se produire ici ou là.
Alors, comment expliquer ce sentiment d’impuissance qui domine quand il s’agit de réformes du système de soin et le constat selon lequel les paroles des ministres ne se traduisent guère dans la réalité ?
On peut évoquer la brièveté des mandats exercés par les ministres successifs (7 ou 8 différents pendant les sept premières années de présidence Macron), ce qui, à l’évidence, ne plaide pas pour une action réformatrice d’ampleur. On y opposera volontiers la présidence précédente, pendant laquelle, la ministre en charge [Marisol Touraine, NDLR] était restée en responsabilité pendant les cinq années de la législature… On peut aussi se tourner vers l’appareil administratif, par nature davantage disposé à reconduire l’existant, qu’à pousser l’innovation, d’autant que sa prolifération continue aux échelons national, régional et local tout au long des dernières années n’en réduit pas la viscosité.
En réalité, il faut convenir que le sujet lui-même, la "santé", est une affaire extrêmement sensible, susceptible de mobiliser autant les patients à titre individuel que les populations et de nature à déclencher des emballements médiatiques*** ; dans ces conditions, il peut être tentant de préserver avant tout l’existant.
Il faut aussi interroger les corps professionnels et leurs représentants afin de bien intégrer comment leur histoire, leur quotidien, la manière dont ils ont été formés et sont arrivés là où ils sont les conduits à voir les choses comme ils les perçoivent, jusqu’à, le cas échéant, être durablement résistants à des évolutions auxquelles ils se sentent étrangers et qu’ils ne peuvent pas porter.
Alors, une fois cette intégration menée à bien, il sera peut-être plus aisé d’aller au-delà des (bonnes) paroles et d’engager les évolutions nécessaires.