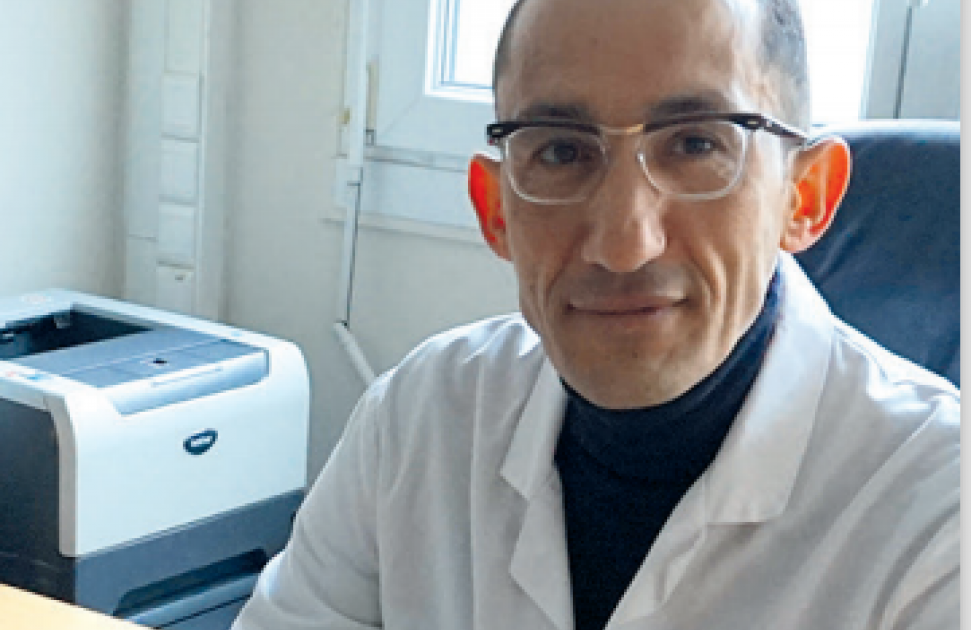"Je suis heureux", lance le Dr Mohad Djouab. Et cela ne fait aucun doute. Avec le sourire aux lèvres, il raconte que son envie d’être médecin "a toujours été une évidence, et ce depuis l’école maternelle". Ce sentiment intime d’un engagement et d’une vocation le conforte dans sa certitude que son destin est celui d’être médecin. Généraliste de surcroît, "dans des territoires colorés", précise-t-il sans vouloir tomber dans les stéréotypes. Le choix de la médecine générale s’impose à lui car "j’avais le sentiment que cela ouvrait le champ d’une médecine sociale, sociétale, scientifique et politique. Pour moi, être médecin, c’est offrir un accompagnement aux soins aux patients, les autonomiser et transmettre un savoir."
D’origine kabyle, il est marqué, enfant, par des inégalités de prise en charge en santé au sein de son entourage proche. Le chemin est tracé. "Mon questionnement sur mon avenir ne s’est jamais posé, mais celui concernant la manière d’exercer ce métier, ce que j’attendais du rôle du médecin généraliste, m’a davantage interpellé." Une réflexion qu’il sculpte au gré de ses études de médecine à la faculté Paris Diderot et de ses stages. L’étudiant est d’ailleurs frappé par les inégalités sociales qui sévissent sur les bancs de l’université.
"La plus grande difficulté n’a pas été les études mais peut-être le fait d’évoluer dans un environnement marqué par une quasi-absence de diversité. Nous étions très peu nombreux à venir de la banlieue et à être enfants d’ouvriers. Je n’ai jamais vécu cette situation comme étant un handicap même s’il a fallu travailler en parallèle des études pour les financer. Au contraire, cela a renforcé mes choix et m’a permis d’avoir une idée très précise de la manière dont je souhaitais exercer."
S’adapter à son patient : une révélation
À la fin de ses études en 1995, le hasard des rencontres lui apporte une diversité de modes et de lieux d’exercice. Il effectue un remplacement en cabinet libéral, assure des gardes aux urgences pédiatriques, consulte et fait des gardes à la maison d’arrêt de la Santé à Paris, et travaille une journée par semaine dans un centre pour migrants en situation de grande fragilité à Lille. On lui propose aussi d’assurer une consultation de médecine au sein du service d’addictologie à l’hôpital Fernand-Widal à Paris, dans le service où il avait fait un stage alors qu’il était interne.
Ce premier stage est une révélation sur l’adaptation nécessaire du soignant à son patient pour établir une relation de qualité. "L’irruption du produit entre le patient et le médecin oblige ce dernier à développer des savoir-être et non plus uniquement des savoir-faire. Les compétences que mobilise cette prise en charge incarnent parfaitement tout ce que peut revêtir une relation de qualité entre un médecin et son patient. Cette expérience m’a confirmé que la dimension sociale et l’environnement du patient sont des déterminants majeurs dont il faut prendre compte, et ce pour tous les patients."
Ces différents postes lui font comprendre qu’il a, à sa portée, mille et une façons de pratiquer le métier de médecin généraliste. "Ce n’était pas de la dispersion, mais de la curiosité et des opportunités qui se sont présentées à moi." Il en tire plusieurs enseignements, notamment que l’exercice libéral isolé ne lui correspond pas. "Avoir une rémunération à l’acte qui finance le médecin de la même manière quelle que soit la pathologie prise en charge est contradictoire avec mon idée du métier. Le médecin doit pouvoir s’adapter en termes de temps, d’écoute et d’investissement vis-à-vis de son patient. Le paiement à l’acte est iatrogène en encourageant l’acte et peut isoler le praticien dans une pratique où il subit l’acte."
De médecin généraliste à directeur de la santé
Les rencontres se poursuivent et le chemin du Dr Djouab croise celui d’une collègue cardiologue de l’hôpital de Gonesse et du centre municipal de santé Henri-Barbusse de Saint-Ouen. Elle lui propose de remplacer un médecin généraliste pendant son congé de maternité. "Je n’étais pas très partant car je cultivais une fausse vision des centres de santé, je les voyais comme des dispensaires. Mais comme je suis curieux, j’ai accepté." Son opinion change très vite. "J’ai trouvé au CMS tout ce que j’attendais de l’exercice de mon métier, une médecine salariée, de proximité, un travail en équipe, et une organisation permettant d’avoir plus de temps avec les patients puisque dégagée de toute gestion administrative."
L’activité du centre augmentant, un poste fixe lui est proposé à la fin du remplacement en octobre 1996. Il met un terme à toutes ses activités, sauf à sa consultation en addictologie. Cinq ans après son arrivée, le directeur de la santé de la ville lui suggère de devenir son adjoint en charge de la prévention, du centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) du service communal d’hygiène, de santé et d’environnement (SCHSE). "C’était un nouveau challenge pour moi. J’ai donc dû diminuer mon temps de consultation de médecine générale au CMS afin de pouvoir développer des actions de prévention dans les domaines de l’addictologie, de la santé bucco-dentaire, du VIH, de l’obésité."
En 2010, autre cap. Le directeur de la santé lui propose de lui succéder. "J’ai accepté car c’était une manière de manifester mon engagement pour cette pratique de la médecine." Avec ce poste, il a l’opportunité d’assurer des fonctions à responsabilités dans différents champs de la médecine qui l’ont toujours intéressé. La prévention notamment, au travers d’outils que sont le contrat local de santé (CLS), l’atelier santé ville (ASV) ou le conseil local de santé mentale (CLSM). "Nous avons plusieurs axes forts autour de la santé de l’enfant avec les programmes de santé bucco-dentaire, le dépistage de l’obésité infantile, des actions autour du cannabis dans les collèges et les lycées, de la sexualité."
Des actions de dépistage à destination de la population sont régulièrement organisées : maladies rénales, mélanomes, cancers du sein et colorectal, diabète. "Cet investissement dans le champ de la prévention est souvent l’occasion de constater le gap qu’il peut y avoir entre les recommandations au niveau national et l’inadéquation de ces messages avec les préoccupations des populations sur nos territoires."
Décloisonner la ville et l'hôpital
Le Dr Djouab a aussi un pied à la faculté, en tant qu’enseignant clinicien associé au département de médecine générale de Bichat, en charge de l’addictologie. "J’ai construit un profil de poste où j’associe le soin, la gestion d’établissements de santé, la formation et la maîtrise de stage universitaire puisque le centre de santé est un lieu de formation pour les internes. J’investis tous les champs de la médecine générale, j’ai des fonctions qui me font passer d’un domaine de compétences à un autre."
Aujourd’hui, il travaille sur le projet de partenariat avec le futur campus hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord (CHUGNP), fusion entre les établissements de Bichat (18e arrondissement) et Beaujon (Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine). "Nous sommes dans l’innovation organisationnelle avec ce projet et cherchons à travailler au décloisonnement entre la ville et l’hôpital afin de réinventer le circuit du patient par davantage de porosité et de pluridisciplinarité."
Et de conclure : "Pour accompagner ce projet, je souhaite associer l’ensemble des professionnels de santé présents sur le territoire au sein d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) actuellement en cours d’élaboration."