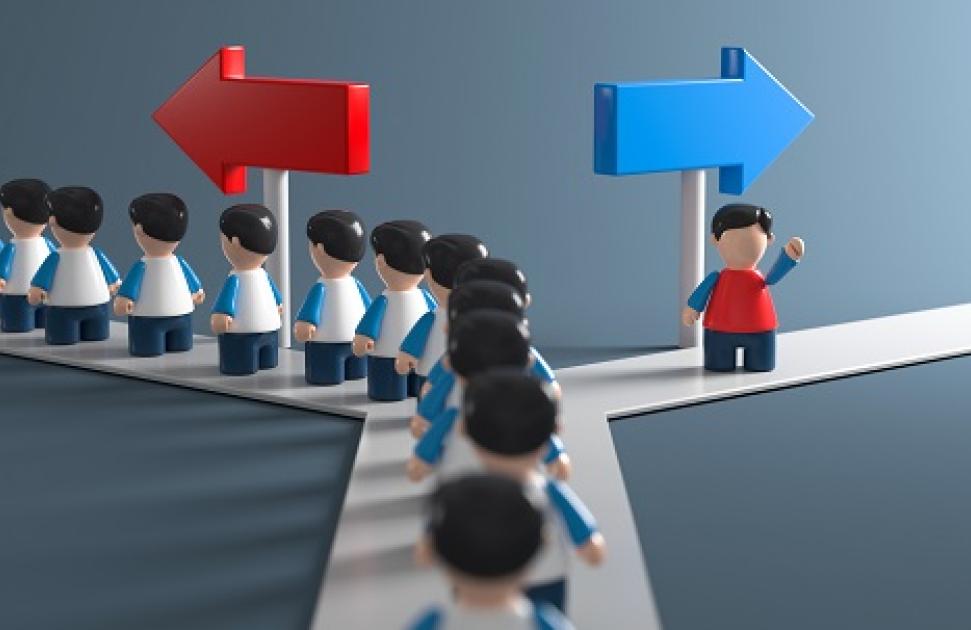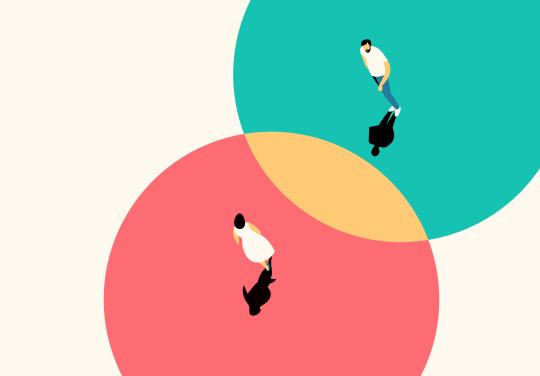Il y a deux ans, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat avait déjà publié un rapport d’informations qui dressait un état des lieux alarmant de l’accès aux soins en France. Face à une situation qui s’est depuis fortement dégradée, cette même commission a exercé son "droit de suite" afin de dresser un nouveau bilan et formuler de nouvelles propositions réparties en 3 axes : cibler des solutions adaptées aux zones les moins bien dotées, accentuer les transferts de compétences des médecins vers les autres professions de santé et, renforcer les efforts d’augmentation et de territorialisation des capacités de formation en santé. "Nous savons que le nombre de médecins en France va diminuer jusqu’en 2028", a déclaré Bruno Rojouan, sénateur de l’Allier et rapporteur de cette mission lors de la présentation des conclusions de la commission. Selon ses estimations, "près de 7 millions de Français seraient sans médecins traitants en 2024", soit presque 700.000 de plus que lors du rendu du rapport de la commission en 2022. "Dans les zones sous-dotées, le renoncement aux soins est 8 fois supérieur au reste de la population, la situation reste donc un problème majeur de notre société."
Face à ce phénomène, la commission a donc rédigé un rapport de 151 pages qui sera publié très prochainement sur le site du Sénat. Au total, pas moins de "70 personnes à la faveur de près de 30 auditions avec l’ensemble des acteurs du système de santé, ainsi que des associations de patients et des collectivités territoriales" ont été interrogées afin d’émettre une liste de propositions. Ce rapport s’est également attardé sur les évolutions législatives de ces dernières années, notamment les lois Rist et Valletoux, et a insisté sur la désormais nécessité de réguler l’installation des médecins. "Les PLFSS de 2023 et de 2024 ont permis un certain nombre de décisions positives, tout comme les lois Rist et Valletoux", a précisé Bruno Rojouan qui a cependant déploré l’absence de "projet global". Pour le sénateur de l’Allier, il s’agit-là d’une "politique des petits pas" située à "des années lumières de ce qu’il est nécessaire de faire pour faire avancer le rapport aux soins en France".