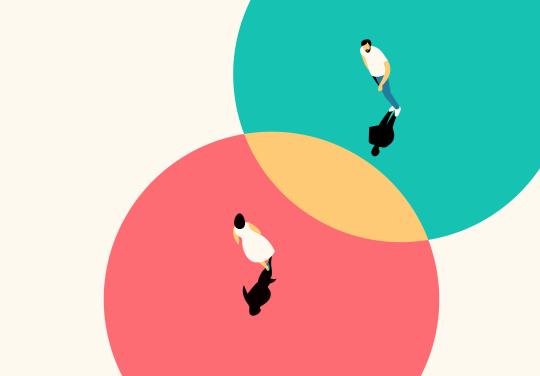"Avec moins de temps de travail, rétorque Christelle Le Coz. Les médecins salariés sont à 35 heures." Dans la salle, Aurélien Noguet, directeur général d’un réseau sanitaire associatif dans le secteur de Saint-Nazaire, se dit "assez heurté" par la mise en avant de statistiques comparant "la performance des médecins salariés et libéraux". Des statistiques dont le calcul a d’ailleurs été interrogé dans un récent rapport de l’Igas.
En réponse, Jérôme Jumel dit se refuser à opposer les professionnels entre eux, et les maisons aux centres de santé. Ce qu’il illustre par des chiffres bien choisis : "On aide à hauteur de 15.000 euros la rédaction d’un projet de santé d’une MSP, et à hauteur de 30.000 euros le lancement d’un centre de santé…" Mais à un autre moment du débat, il assume de parler "cash" face au contexte économique : "Aujourd’hui, en tant que directeur d’une ARS, objectivement, il vaut mieux pour moi, en termes de subventions d’équilibre à apporter et à cadre budgétaire constant, qu’il y ait plus de MSP qui se développent que de centres de santé..."

crédit : Co'santé
Les aides de l’ARS ne sont pas tout. Le financement des centres de santé se joue aussi au niveau conventionnel – une renégociation est en cours avec l’Assurance maladie – et dans l’arène politique. En ont témoigné, lors de ce débat nantais, les parlementaires de gauche Guillaume Garot, Jean-Claude Raux et Karine Daniel. La bataille n’est pas gagnée d’avance, selon la dernière de ces trois élus des Pays de la Loire. Au Sénat, où elle siège, "l’écho donné au développement des services de santé sur tous les territoires n’est pas aussi favorable qu’à l’Assemblée nationale".
"Il n’y aura pas de solution aux déserts médicaux sans les centres de santé, résume le député Guillaume Garot. Il y a cinq ans, on en parlait peu ; aujourd’hui, c’est une vraie réponse pour des millions de Français." Reste donc à leur faciliter davantage le travail. Après avoir exploré les textes officiels, Christelle Le Coz cite une poignée de mesures, parmi lesquelles la possibilité introduite tout récemment de CDD dérogatoires au Code du travail pour les médecins exerçant dans certains centres de santé, ou le relèvement à 75 ans de l’âge maximal du cumul emploi-retraite des médecins en centres de santé. "Ce n’est quand même pas beaucoup. Nous avons besoin d’une stratégie institutionnelle de développement."